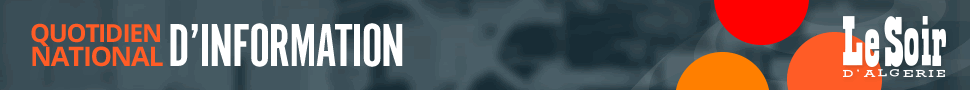2- Associés dans la même entreprise, Emmanuel Alcaraz et Aïssa Kadri n’en sont pas moins dissemblables, mesurés à l’aune d’autres étalons.
Je ne connaissais pas le premier, je ne l’ai jamais rencontré ni discuté avec lui, nous n’appartenons pas à la même génération, lui est français, moi algérien, nous n’avons pas eu le même itinéraire ni la même formation universitaire.
Avec Aïssa Kadri, c’est une autre paire de manches. Nous avions presque le même âge, nous nous sommes connus lorsque l’université algérienne, dirigée par le social-chrétien André Mandouze, était traversée par un melting-pot de courants idéologiques incarnés, majoritairement, par la gauche marxiste, l’extrême gauche trotskiste, le nationalisme orthodoxe des historiens Mahfoud Kaddache, ancien militant du PPA-MTLD, et Belkacem Saâdallah et, accessoirement, par l’islamisme version Ahmed Aroua.
La formation que nous avions tous les deux suivie était, pratiquement, la même, certes, décalée dans le temps : je l’avais, en effet, précédé à l’Institut d’études politiques et aussi en sociologie où j’étais inscrit aux cours des certificats de sociologie générale et d’ethnologie — les modules indépendants de l’ancien système — donnés, respectivement, par le professeur Sicard et le déjà très connu écrivain et militant de la cause identitaire, Mouloud Mammeri, assisté de Youcef Nacib que je retrouverai, le premier, en 1970, à la radio et, le second, en 1990, à l’Association des éditeurs algériens que nous avions co-fondée, sous la présidence du directeur général de l’ex-Sned, ancien membre du Malg, M. Bouzid.
La proximité entre nous deux — et non le compagnonage qu’il prétend — s’arrêtait là. Nous ne partagions ni les mêmes origines sociales ni les mêmes valeurs et, par conséquent, nous nous situions aux antipodes l’un de l’autre en termes d’engagement militant.
Quand moi je représentais, à l’âge de 19 ans, l’Institut de Sciences-Po au conseil de section d’Alger de l’Unea historique, et, quelque temps plus tard, à 23 ans, travaillais à l’UGTA en tant que conseiller de Mouloud Oumeziane, secrétaire général, on ne connaissait à Aïssa Kadri aucune affiliation syndicale ou politique ; il se contentait de commenter l’actualité à partir de la terrasse de la Brasserie des facs, avec une morgue d’oppositionniste acariâtre qui contrastait avec la forte mobilisation des étudiants et de la jeunesse, en général, sur les chantiers des tâches d’édification de l’Etat national, un chantier stratégique qu’il avait, volontairement, déserté, et dont il se gausse, aujourd’hui, en injuriant, avec une hargne d’aigri, «l’engagement d’intelligentsia aux ordres qui ont accompagné la faillite de l’Etat». Elles apprécieront ! Il va jusqu’à affirmer que les étudiants qui avaient rejoint l’ANP durant l’été 1967 l’ont fait sous la contrainte, «caporalisés».
Savait-il — mais comment le démissionnaire hédoniste qui se complaisait dans le dénigrement l’aurait-il su ? — qu’à la fin de 1965, à la salle de cinéma Atlas, les étudiants de l’Unea s’étaient retrouvés face au colonel Mohand Oul Hadj et Abdelaziz Bouteflika, membres du Conseil de la Révolution, pour amorcer un dialogue politique avec la direction du «Pouvoir révolutionnaire» issu du 19 juin, et que leur engagement ultérieur, au sein de l’armée, aux côtés de la cause des peuples arabes, que nombre d’entre eux ont payé de leur vie sur la ligne Bar-Lev du canal de Suez, déboucha, l’année d’après, sur l’institutionalisation du service national dont les Algériens célèbrent, ces jours-ci, le 50e anniversaire.
Les lycéens et les premiers étudiants qui se bousculaient, dans la chaîne des candidats — dont j’étais — au départ, trois années plus tôt, vers les frontières sahariennes de l’Algérie, menacées par un Maroc belliqueux, ont-ils été, eux aussi, bernés, victimes d’une manipulation de masse ? Une manipulation qui les aurait jetés comme des moutons de Panurge, en 1964, dans les imposants défilés du 1er mai pour soutenir les luttes ouvrières, sur les crêtes de l’Arbaâtache pour les reboiser, dans les écoles des villages pour alphabétiser les paysans et dans les cinébus du Centre algérien du cinéma pour projeter, dans les coins les plus reculés de la Mitidja, Algérie en flammes et Djamila.
Le différend qui nous oppose, aujourd’hui, lui et moi — les lecteurs l’auront noté — n’est pas personnel, fortuit ; il a des racines et renvoie à un faisceau de raisons de fond qui nous dépassent en tant que simples individus.
En 2009, j’avais publié une analyse sur les élites algériennes, incluse dans un des chapitres de mon essai sur «Les présidents algériens à l’épreuve du pouvoir», à travers laquelle j’ai cherché à cerner les facteurs qui expliquent les incohérences de l’élite et l’opposition de ses composantes, les unes aux autres, en relation avec leurs origines, leurs parcours initiatiques, leurs langues et leur positionnement vis-à-vis du colonialisme et de la révolution armée et, après l’indépendance, à l’égard de l’Etat national. Et j’ai dû me rendre à l’évidence qu’en effet il était impossible que ses différents segments puissent se rejoindre et former une force homogène éligible à la direction de la Révolution de Novembre, et de l’Etat renaissant. Cette élite hétéroclite de fils des grandes tentes féodales, d’ulémas de la petite bourgeoisie citadine, de transfuges de la bourgeoisie libérale et, plus essentiellement, de nationalistes populaires — «le peuple tout entier», la formule caricaturale employée par notre sociologue «wébérien» pour les désigner, en piochant dans le lexique de l’ancienne culture soviétique de ses nouveaux amis parisiens —, cette élite était dans l’incapacité de présenter un front uni. Les nationalistes populaires étaient condamnés à faire cavalier seul «laissant sur le bord de la route» les attentistes et, évidemment, ceux pressés d’entrer dans les tabors des mokhaznis, en contrepartie du salaire de la soumission.
Nous fûmes, tous les deux, comme beaucoup de jeunes Algériens de l’époque, déterminés par la logique et les dynamiques de ces luttes politiques et sociales de notre peuple que certaines parties de l’élite ont endossées et contribué à conduire jusqu’à la victoire finale et que d’autres ont, par opportunisme ou intérêt de classe, délibérément reniées et combattues.
Qu’il appelle cela «sagacité de petit commissaire du peuple» ou déterminisme mécaniste importe peu et ne change rien à cette implacable vérité qui veut que la différence qui sépare Aïssa Kadri et moi réside là et nulle part ailleurs. Elle explique, du reste — c’est symptomatique d’un négationnisme qui jaillit spontanément — qu’il me dénie, de connivence avec Alcaraz, le droit de défendre la mémoire des martyrs de la patrie, y compris celle des miens — des fidayine guillotinés à l’âge de 25 ans et des moudjahidine morts les armes à la main — préférant, peut-être, que je les taise, la tête baissée, devant les rodomontades des filles de bachaghas, coupeurs d’oreilles, qui chantent «les exploits» des collaborateurs de la colonisation que Rachid Boudjedra fustigea, à juste titre, dans Les contrebandiers de l’Histoire.
Aussi, lorsque je pris connaissance de «sa plaidoirie» égarée dans le caniveau des insultes où il a abîmé ses discours soporifiques sur l’école et l’éducation qu’il nous assène, depuis des années, dans les colonnes de certains journaux, je ne fus pas étonné, outre mesure, alors que je lui avais tendu la perche pour répondre avec la tête, pas avec les pieds, aux questions posées par mes différents articles.
Je ne fus pas étonné, en effet, car je retrouvai là le Aïssa Kadri d’antan, brouillon, pusillanime, doutant de tout, à commencer par soi-même, mal assuré, s’en prenant à tout le monde, dans la langue de l’inquisition et de la médisance, le signe patent d’une grosse frustration qu’il traînait d’avoir raté sa carrière à Alger, après avoir été le plus vieil étudiant de l’Université, battant tous les records de longévité sur ses bancs.
Et dans une pirouette lamentable qui lui ressemble bien, il me traite d’autodidacte — merci pour les autodidactes que je respecte ! —, démuni de titre, réveillant le pauvre Jean-Paul Sartre — pas moins que ça ! — de son profond sommeil pour l’attester. Mais M. Kadri, avant d’aller troubler le repos éternel du juste que fut le père Sartre, consultez le Littré pour vous enquérir du sens de l’autodidactisme et si, d’aventure, cela vous intéresse toujours, et vous servirait à quelque chose — par exemple l’encadrer et en garnir un des murs de votre salon —, je tiens à votre disposition une copie de mon diplôme obtenu il y a 53 ans — que d’eau a coulé depuis ! —, accompagné d’un jeu de mes ouvrages que Chihab et Casbah ont tirés à des milliers d’exemplaires, à la condition que vous en fassiez de même et que vous m’envoyiez un jeu des vôtres, les vrais — s’il en existe —, pas les préfaces dont vous êtes devenu un spécialiste prodigue que vous distribuez à droite et à gauche, comme des savonettes, même à des romans comme La débâcle où un des personnages accuse l’Emir Abdelkader d’avoir acheté des armes chez les Français pour mater une mutinerie des Darkaoua (!). Et me reviennent à l’esprit vos volte-face et vos retournements de veste anciens, adulant le lendemain ce que vous brûliez la veille, reconnaissant vous être trompé et demandant pardon comme vous le faites aujourd’hui, avec une versatilité déconcertante.
Je constate, cette fois-ci encore, avec un certain amusement, la confirmation de ce trait de caractère qui relève plus du marivaudage que du sérieux attendu du «clerc» — celui de Julien Benda, peut-être ? — que vous dites être devenu, car après toutes vos circonvolutions, vos protestations théâtrales et vos cris d’orfraie, vous finissez, benoîtement, par avouer que vous n’êtes, en effet, qu’un simple sociologue — de surcroît «incestueux» — qui n’a aucun titre académique en Histoire qui vous autorise à valider, scientifiquement, un travail d’historien, découvrant — la belle excuse tirée par les cheveux — que les frontières entre Histoire et sociologie sont «épistémologiquement indiscernables».
Toute cette montagne que vous aviez, péniblement, érigée pour n’accoucher que d’une petite souris bâtarde, «inventant» une sociologie métissée que vous nous sortez de votre alambic et qui va dégrader encore plus l’image d’une discipline plus spéculative que prospective, ternie, depuis mai 1968, par la démonstration de son incapacité à comprendre et à anticiper les mouvements tectoniques de la société dont Edgard Morin qui n’était pourtant pas un enfant de chœur, en avait fait la triste expérience. Que dire si vous lui offriez la mémoire en pâture ? Nous en frissonons d’épouvante, rien que d’imaginer, d’ici, les dégâts que cela provoquerait.
Et comme votre ami Alcazar, une fois piégés, vous cherchez à esquiver : vous nous sortez ce barbarisme de «déterritorialisation» destiné à banaliser votre embrigadement au service des faussaires de l’Histoire, et profiter, au passage, pour me présenter aux yeux de mes compatriotes résidant à l’étranger sous les traits d’un fieffé cacique qui les empêcherait de réaliser leur ambition d’élargir leur horizon scientifique à l’étranger, tout le contraire de ce que je souhaite. Qu’ils cherchent à atteindre et à maîtriser les technologies les plus avancées au monde, pour leur compte personnel ou pour celui de leur pays d’origine — directement, indirectement ou même à titre honorifique — est tout à fait recevable et mérite encouragement et stimulation. J’y adhère pleinement, parce que j’estime que cela ne pourra que servir, positivement, le background scientifique de l’Algérie. Ce qui n’est pas, exactement, la même chose quand «la déterritorialisation de la recherche» que vous défendez et préconisez, dangereusement, concerne l’Histoire et la mémoire de notre Nation que vous nous invitez, de façon irresponsable, à aliéner au profit d’investigateurs étrangers qui nous ont tenu, depuis 1830, pour «un ramassis de peuplades sans Histoire ni civilisation, vivant sur un territoire n’appartenant à personne».
Votre ancienne co-disciple à l’IEP, Zohra Mahi, qui a fait paraître, sur la question, un ouvrage saisissant de vérité, dont j’ai cité les références dans la première partie de ma réponse, a écrit dans son prologue : «Les livres et les témoignages sur la colonisation et la guerre d’Algérie ont été le fait, pour leur grande majorité, de Français : écrivains, historiens, militaires, pied-noirs qui donnaient leurs versions des faits. Certains, pour ne pas dire la majorité, avec une très grande habileté, faisaient des analyses et des commentaires subtilement orientés où le parti-pris était évident.»... Ces narrateurs partisans «persistent, toujours, poursuit-elle, à travestir la réalité jusqu’à inverser les rôles et à mettre sur un pied d’égalité l’agresseur et l’agressé. Alors, que faire face à cette obstination insupportable des peuples persuadés de leur supériorité et de l’infériorité des autres ? Ecrire, justement ! Consigner tout, noir sur blanc, parce que, selon le mot de Comte-Sponville, «on écrit lorsqu’on ne peut ni parler ni se taire».
Le résultat de sa résolution d’écrire l’Histoire de la conquête coloniale, sur le territoire de l’ennemi d’hier, fut admirable. Elle me le fit parvenir accompagné d’un mot où elle m’apprit qu’elle avait conçu ce livre en réponse à l’interpellation que j’ai adressée aux intellectuels algériens résidant en France, leur reprochant leur silence assourdissant, suite aux déclarations faites par Michel Onfray, lors de son passage à Alger, déclarations auxquelles j’avais réservé le sort qu’elles méritaient.
Le titre et le contenu de ce livre, jeté aux oubliettes, en France, pour les raisons que l’on devine, m’était revenu, à l’esprit, en lisant votre texte plein d’animosité gratuite, et je m’étais alors posé la question de savoir pourquoi Zohra Mahi, placée dans les mêmes conditions que vous — auto-exilée, installée en France, depuis 1990 —, a choisi, avec un courage digne d’éloges, non pas d’attaquer l’Etat, les élites et la société de son pays d’origine, mais de porter la contradiction chez eux, aux affabulateurs, dans le même temps où vous vous vous êtes rangé, sans état d’âme, à leurs côtés et même sous leurs ordres pour médire de l’Etat — sans discernement ni distinction — qui vous a formé et des élites qui ont relevé le défi de sauver le pays des mains de ses prédateurs obscurantistes, en attendant de le faire des mains des faux capitalistes?
J’ai conclu que la ligne qui vous sépare de Zohra Mahi et la même qui nous sépare : celle qui différencie les patriotes des autres, rouge et infranchissable ; la même, au demeurant, qui vous tient à distance des martyrs Liabès et Boukhobza et des feu Aït-Amara, Guérid et Saâdallah que vous appelez à la rescousse avec l’énergie désespérée d’un noyé accroché à sa bouée de sauvetage. Et pourtant, leurs exemples ne servent pas votre argumentaire. Tous sont revenus au pays pour y développer les bases des écoles de sociologie et d’Histoire, quand bien même ils se seraient expatriés, pour un temps, les uns à la recherche des archives et outils de travail qui leur manquaient comme Belkacem Saâdallah, parti aux Etats-Unis avec Mahfoud Benoune, les autres intéressés à perfectionner leurs techniques de recherches.
Aït-Amara, menacé par les intégristes et parti enseigner à Montpellier, est revenu rapidement à Alger, pour se consacrer au lancement de son association altermondialiste. Fier comme je le connaissais, il avait confié à son entourage qu’il préférait mourir chez lui plutôt que de continuer à subir les humiliations racistes de l’aristocratie universitaire française.
Vous savez ce qu’il en coûta à Liabès et à Boukhobza de s’être sourcés à la même matrice. Ils payèrent de leur vie leur attachement à leur peuple dont ils tenaient à partager les souffrances jusqu’au bout, malgré les obstacles, souvent décourageants, placés, exprès, sur leur route par les bureaucrates de l’Université d’Alger que vous connaissiez bien. Le plus intrigant est que, dans la liste des sociologues et des historiens cités, vous ne parlez pas du tout des professeurs Messaoud Lekouaghet, Abdelhamid Zouzou et Bouzida qui vous ont tenu la dragée haute sur les travées de la faculté. C’est vrai que vous en étiez à «objectiver les causes de la dérive du pays» avec un groupe non identifié ; et vous me posez deux questions : «M. Mili, où étiez-vous ?» et «qu’est-ce que vous êtes au juste ?».
Comme c’est facile, une fois la tempête passée, de poser ce genre de questions à partir du confort de votre résidence parisienne, qui vous a protégé des houles auxquelles le pays avait été exposé, vous contentant «d’objectiver» sans vous salir les mains avec le cambouis de son quotidien !
Où étais-je ? J’étais du côté de la barrière où vous n’étiez pas : le plus dangereux, celui qui exige des sacrifices et qui n’était rémunéré que par la rente du courage et de l’intégrité intellectuelle, pas par la rente de l’auge à laquelle vous pointiez grassement.
Je vous fais l’économie de citer toute les stations de ma longue «servitude» patriotique passée à sillonner les champs de bataille de la Révolution agraire, du développement régional, de la médecine gratuite, de la sécurité sociale, du non-alignement et des mouvements de libération africains, palestinien, vietnamien et latino-américains. Je ne m’arrêterai qu’à celles qui suscite votre fausse curiosité.
Où étais-je durant la décennie noire ? Eh bien, j’étais, ainsi que vous le savez pertinemment, puisque vous y faites allusion, sur les lieux que vous aviez, comme toujours, désertés. J’étais présent et actif sur la tranchée du sauvetage de l’Etat républicain, à la modeste place qui fut la mienne, d’abord en tant que candidat aux élections législatives de 1991 — la poitrine exposée au feu — pour barrer la route au déferlement fondamentaliste, ensuite, au sein du cabinet du Président Liamine Zeroual, au service de son programme de redressement national et de réforme de l’Etat, dans le volet de la communication qui s’y rapporte, à travers, en l’occurrence, la rédaction et la popularisation de la directive présidentielle n° 17 qui, si elle avait été mise en œuvre et non contrariée comme elle le fut, aurait révolutionné le monde de la presse et de l’audiovisuel public. Et si, en même temps, je m’étais retrouvé à la Direction générale de l’APS, c’est parce que j’y étais nommé par le Président, afin d’y appliquer le dispositif prévu par la directive, tâche dont je me suis acquitté sans en tirer le moindre privilège matériel ou sécuritaire gratifiant. Et maintenant que je me suis libéré de toutes les attaches partisanes et étatiques, y compris de celle qui m’avait lié à la Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen où, pendant dix ans, j’ai travaillé, en tant qu’expert, à créer avec les acteurs des médias publics un espace de culture et de communication respectueux de l’authenticité et de la liberté des peuples du nord et du sud de la Méditerranée, je me consacre à un travail d’écriture, de réflexion et de création dans les domaines littéraire, politique, et, même, cinématographique dans le but de transmettre à ceux qui veulent bien me lire et me suivre les leçons d’une vie qui méritait d’être vécue au sens où Pablo Neruda l’entendait.
Vous me demandez, aussi, ce que, finalement, je suis, au juste. Je pense, sincèrement, être devenu ce que les luttes menées, depuis 60 années, par mon peuple ont voulu que je devienne : l’un des modestes reflets de sa conscience m’aidant à tenir le cap, loin de la courtisanerie obséquieuse des régimes et des hommes qui passent, aussi bien que de la critique subjective et déplacée du travail de l’armée des anonymes de l’Algérie de l’honneur, grâce auxquels le pays est debout, continuant, d’arrache-pied et, à partir de ma position d’intellectuel engagé et de citoyen vigilant, à aider, par les analyses et les œuvres de l’esprit que je produit, régulièrement, à faire avancer la cause du progrès et de la liberté auxquels aspire ma société dans l’esprit et la lettre des promesses de Novembre. Et cela, sans être l’adjoint de qui ce soit d’autre que de ma seule conscience devant laquelle j’ai, toujours, été comptable de mes convictions et de mes actes.
Je doute fort que vous puissiez comprendre cette disposition d’esprit morale et politique avec laquelle j’ai grandi et compte aller le plus loin possible.
Nos routes étaient, dès le départ, divergentes. Comment voulez-vous qu’aujourd’hui elles se croisent ? Et pourquoi faire ? Monter un cheval de Troie et le faire entrer dans la cité ? Accepter et faire accepter que le 15 septembre soit fêté comme journée nationale du harki en France et s’interdire en Algérie de parler des martyrs autrement qu’en opposant leurs mémoires les unes aux autres ? Chanter, à l’unisson, le métissage de l’Algérie plurielle, le rêve avorté des libéraux de Jacques Chevalier, l’ancien maire d’Alger, condamné par l’Histoire ?
Ce ne sont, là, que chimères et illusions que vous feriez bien, avec votre ami Alcaraz, de rengainer et de dire à vos maîtres-souffleurs de sortir du bois et de venir m’affronter, à visage découvert, sans intermédiaire. Et si j’ai un conseil à vous donner, pour ce qu’il pourrait vous servir, à l’avenir, c’est d’éviter de faire croire aux lecteurs que vous rotez du caviar quand, tout au long de l’année, vous vous gavez d’ail et d’oignon...
B.-E. M.