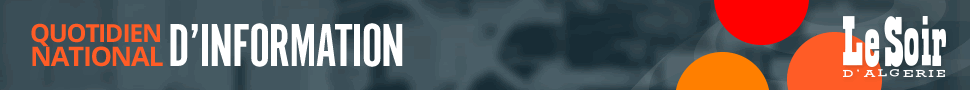Parfois, le silence te renvoie plus de clameurs que le pire des brouhahas. C’est ce silence ténu, incisif, qui s’insinue en toi, encore tenace, pénétrant, à l’issue de la projection de 143 rue du désert, le second long métrage de Hassen Ferhani. Quel uppercut a-t-on reçu pour être à ce point sonné?
Déjà très remarqué en 2015 pour son premier long-métrage, Dans ma tête, un rond-point, celui-ci avait décroché plusieurs récompenses dont le Grand Prix de la compétition française au FID de Marseille.
En quittant la salle, on titube dans la double sensation d’avoir à la fois assisté à la renaissance du cinéma algérien en phase d’être connecté avec son temps, et à la naissance d’un grand cinéaste. Pari à tenir ! C’est au ciné-club La Chrysalide d’Alger dont il fut l’un des animateurs, que Hassen Ferhani a forgé ses armes esthétiques. Ce ciné-club semble avoir été un terreau de jeunes talents à même de renouveler non seulement le cinéma algérien enkysté dans les fers du conformisme, mais surtout l’esprit dans lequel se bat et s’épanouit un septième art affranchi des diktats idéologiques étatiques pour s’enraciner dans les profondeurs et les douleurs de la rue algérienne, poussée à son degré extrême de poésie.
Inutile de chercher à savoir si ce film est une fiction ou un documentaire même s’il est annoncé comme tel. Hassen Ferhani, lui, ne se pose pas la question du genre.
Il n’est pas sans rappeler cette réflexion de Gabriel Garcia Marquez introduisant Récit d’un naufragé, qui était à l’origine un reportage journalistique. En 1955, Marquez, journaliste à El Espectador à Bogota, en Colombie, publie un récit en 14 épisodes inspiré d’une interview avec Luis Alejandro Velasco, seul survivant des 8 marins du navire de guerre Caldas, tombés à la mer. Le gouvernement imputait le naufrage à une forte tempête. Mais le naufragé confia au journaliste qu’il n’y avait jamais eu de tempête et que les marins avaient basculé par-dessus bord à cause d’un chargement d’appareils électroménagers mal arrimés, importés des USA et qui n’avaient bien sûr pas leur place sur un navire de guerre. Il s’agissait donc d’un récit journalistique qui n’avait absolument rien de fictionnel. Quand il fut publié en ouvrage, Marquez révéla dans l’introduction que son seul problème était alors de parvenir à convaincre le lecteur que ce n’était pas une fiction. Le film de Hassen Ferhani n’est pas un remake de Bagdad café trempé dans le spleen saharien.
143 rue du désert est un documentaire qui dépasse la fiction sans avoir cherché à se mesurer à elle. On a l’impression que les personnages, à commencer par Malika, survivante elle aussi à un naufrage, celui de sa destinée, et celui d'un monde, ne sont pas des personnes saisies dans leur vie ordinaire par l’intrusion d’une caméra bienveillante, mais des personnages de fiction nés de l’imagination onirique d’un scénariste.
La scène du rêve ? 20 m2. Une baraque dans le désert, à 50 km d'El-Goléa sur la route transsaharienne. C'est une gargote où les routiers, les touristes et les gens du pays s'arrêtent pour boire un thé, acheter des cigarettes à l'unité ou avaler une omelette au sable. Malika, 74 ans, règne sur ce royaume du dénuement et de l'aridité. Elle parle aux gens, elle écoute les gens. Elle est loin de tout, et elle sait précisément ce qui se passe partout. Loin du monde, le monde vient à elle, charrié dans son tumulte et ses doutes par des baliseurs du désert familiers de ce vide où sont embusquées tant de présences ambiguës. Le monde, vidé de sa substance, est là par les pétarades des motos des Apaches, ces touristes insolites dans la plénitude du néant, par les vrombissements du moteur des camions, par les confidences d’une Polonaise aventurière qui porte les portraits des siens sur son smartphone, par les bobards d’un voyageur en escale qui prétend être à la recherche de son frère, par Chawki Amari qui simule la résignation goguenarde d’un détenu du désert.
Malika a un don : déchiffrer les âmes. Une femme réduite à son plus simple langage, c'est-à-dire à sa vérité première, l’intuition, celle d'avant la rhétorique et même d’avant la parole.
Le film est un huis clos, au sens théâtral du terme, où, autour de l’axe central qu’est Malika, gravitent des météores de destins enserrés dans des fragments. C’est une heure et demie de prospection de la belle âme de Malika et de la musique que produisent sur elle les heurts d'un pays englué en lui-même. La caméra de Hassen Ferhani est tour à tour plume, scalpel, palette, instrument. Un film polyphonique en émotions qui n’a d’autre prétention que de livrer des morceaux de vie, dans la discontinuité et la fulgurance, mais qui réussit à rendre le malaise ontologique de l’Algérie du silence et de la résilience. Toute la densité d’un pays dépossédé de son âme et pourtant irrésolu au déclin est enfermée dans le regard de Malika posé sur l’horizon.
Hassen Ferhani nous rappelle, avec le langage des images et la didactique des mirages, des vérités essentielles chassées de nos univers par la dictature du succès : une belle vie, c’est d’abord une vie où on transforme la douleur en beauté. C’est exactement ce que fait Malika. Et c’est exactement ce que fait le réalisateur.
A. M.
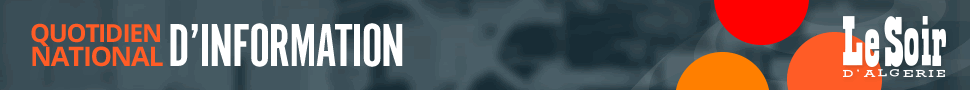
Rubrique Ici mieux que là-bas
Malika ou L’agonie du sablier

Multimédia
Les + populaires de la semaine
-
- Sports
- 19:00
- 24-04-2024
Affaire USM Alger - RS Berkane La décision de la CAF tombe !
-
- Actualités
- 17:41
- 19-04-2024
Coupe du monde de gymnastique L'Algérienne Kaylia Nemour s'offre l'or à Doha
-
- Actualités
- 12:52
- 21-04-2024
Demi-finale aller de la Coupe de la CAF Le match USM Alger - RS Berkane compromis, Lekdjaâ principal instigateur
-
- Sports
- 11:00
- 20-04-2024
Le stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou pourrait abriter le rendez-vous La finale se jouera le 4 mai
-
- Actualités
- 21:42
- 21-04-2024
Coupe de la CAF, le match USMA-RS Berkane ne s’est pas joué Les Usmistes n’ont pas cédé au chantage
-
- Sports
- 23:00
- 20-04-2024
Temps d’arrêt Lekdjaâ, la provocation de trop !