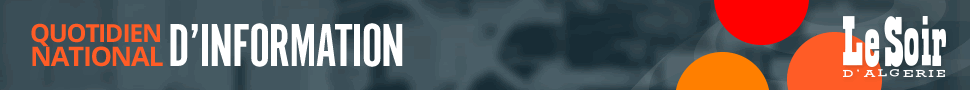Il est quand même rassurant que l’Algérie puisse se prévaloir encore d’un certain talent pour évoquer le passé. Terre fertile en créativité littéraire, elle demeure la muse inspiratrice d’une multitude de prosateurs au point de laisser se commettre en son nom d’approximatifs ouvrages dont les auteurs sont souvent de modestes plumitifs.
Engrossée par des décades de malheur, elle a tout de même élevé au cénacle des grands témoins quelques auteurs réfractaires aux discours convenus et plutôt doués pour la vigueur verbale. À cela il y eut, semble-t-il, une bonne raison qui fit que les livres majeurs soient écrits, pour la plupart, avec une encre particulière : celle qui décrit sans fard le marasme d’une société trahie et rabaissée par les princes qui la gouvernent.
C’est précisément de cet héritage laissé par des scribes tutélaires que s’inspirèrent par la suite des disciples qui nous ont éclairés au sujet des impostures du présent. Il est vrai qu’en Algérie, la littérature n’a jamais été une vocation jubilatoire dévolue à quelques talentueux conteurs. Avant tout, elle s’est effectivement imposée comme un devoir grave, aussi bien par la tonalité de ses textes que par l’éclairage des révélations compromettantes qu’ils détiennent.
C’est dire que le roman algérien n’a rien de l’épître prudente mais il est en permanence plus près du réquisitoire. Car la noirceur du récit est quelque part symptomatique de la morosité voire du désespoir qui accable le pays. Il est vrai que dans cette contrée des paradoxes, ceux qui ont confisqué le pouvoir s’usent moins vite que les pauvres sujets d’une drôle de République. C’est pour cette raison qu’il s’en est trouvé que les meilleurs récits étaient ceux qui s’attachaient à la thématique de la terre blessée et de l’Algérien vaincu par les iniquités.
À ce propos d’ailleurs, un critique littéraire constatait, par un passé récent, que «même le souffle épique de Novembre 1954 s’était éteint et son souvenir semblait s’être perdu aussi». Terrible constat à peine démenti par la grande geste du peuple qui avait inspiré de talentueux narrateurs et de sublimes poètes dont les œuvres peinent à trouver un lectorat de nos jours.
Autant de textes témoignant d’une grandeur bradée par un système politique de prédateurs. Kateb Yacine fut certainement le plus représentatif parmi les écrivains engagés. Depuis, n’avait-il pas fallu patienter durant une longue période avant d’assister à l’émergence d’un auteur d’une autre stature notamment par sa manière de traiter du malheur de son peuple. Il avait un talent certain et un rayonnement incomparable au point de devenir la cible du terrorisme islamiste qui l’exécuta le 26 mai 1993. Il a pour nom Djaout et prénom Tahar et n’avait pas encore 40 ans à la date de sa mort. Pourtant, il était déjà considéré comme une majestueuse plume lorsqu’il publia en 1992 le prémonitoire opus intitulé Le dernier été de la raison. Une confirmation qui a fait de lui un écrivain majeur après s’être fait connaître grâce à un autre récit titré Les vigiles d’où il est aisé d’extraire un passage significatif consacré au délire islamiste. «Ce qui est effrayant chez cette nouvelle génération de dévots zélés, écrivait-il, c’est sa négation même de toute joie, son refus de toutes les opinions différentes et son rêve de soumettre le monde aux rigueurs d’un dogme inflexible.»
D’ailleurs, plus d’un quart de siècle après sa mort, comment peut-on se contenter de parler toujours du rayonnement de son œuvre inachevée sans évoquer les misérables postures de certains écrivains que l’indigne veulerie avait contraints à, presque, justifier son assassinat. De tous ses contempteurs expliquant cette barbarie par un curieux parallélisme permettant de comparer les procès nés de la plume du scribe et le révolver de l’imam délirant, celui qui fut le plus féroce n’était autre que Tahar Ouattar.
Secrétaire général de l’association culturelle El Jahidhia après avoir servi le parti unique comme propagandiste, il se rendit tristement célèbre en tenant des propos indécents sur les raisons qui débouchèrent sur le décret de la mort. Sans la moindre hésitation ou le plus petit accent de compassion, il se comporta comme un fasciste épurateur pour qui, même le meurtre d’un poète mérite justification. Plus tard, c’est-à-dire à l’été 2010, année de son décès, les propos concernant Djaout furent exhumés afin de leur donner une seconde explication.
En effet, à travers un faire-part nécrologique publié dans le journal Le Monde, son éditeur admettait que les propos «malheureux» de Ouattar ne traduisaient en définitive que «la guerre des langues et des castes qui a longtemps opposé les intellectuels» algériens. Une assertion aussitôt démentie par plusieurs universitaires et notamment ce qu’en disait Djaout sur ce sujet. Citant Le dernier été de la raison, l’universitaire Djouhar Amhis avait justement dédouané Djaout de la moindre inclination vers les ostracismes linguistiques.
«À travers cet ouvrage, disait-elle, il dénonçait vigoureusement l’atteinte aux langues nationales et préférait porter la réflexion à un haut niveau en refusant le nivellement par le bas.»(1)
Même si les propos de l’auteur des Noces du mulet avaient vite été considérés comme des dérapages sans conséquences notables, ils demeurèrent néanmoins révélateurs de sa propension au sectarisme au point de l’assimiler à un crypto-islamiste. Lui qui avait sciemment associé l’usage de la langue arabe à l’imprécation religieuse ne pouvait que tenir en haute suspicion tous les locuteurs d’une langue étrangère. À ce titre, pouvait-il attester d’autre chose que de crier au complot contre la langue arabe en désignant ses «ennemis complémentaires» dont Djaout fut le premier martyr qui croisa le chemin de son bourreau ? C’est de la sorte que naquit la fable du «poète assassiné par un marchand de bonbons sur ordre du tôlier».(2)
Ouattar jouant au vieil ami crédule accorda du crédit à la légende et reprocha au cadavre du poète d’avoir été le premier à malmener la foi religieuse des petites gens. Comme quoi, les dresseurs de bûchers ne sont pas toujours ceux que l’on croit.
B. H.
(1) Citation reprise d’un compte-rendu de presse paru dans El Watan du 2 mai 2011.
(2) La formule a été rapportée par Arezki Aït El Arbi.