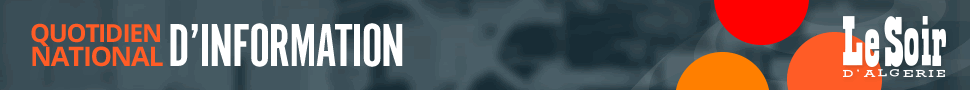En dépit de tous les malheurs qui ponctuèrent ses trente dernières années, l’Algérie demeure, tout de même, une terre fertile en créativité littéraire.
C’est ici dans ce pays à l’histoire tourmentée que souffle précisément un verbe vigoureux sans comparaison aucune avec celui venant des terres voisines qui n’évoque que tristement la mélodie du plein-champ allusive à quelque Andalousie imaginaire. Au contraire, l’écriture en Algérie est rarement jubilatoire tant par ses thèmes que par le souci de plaire. Ici, la littérature n’est jamais une romance sentimentale au point que ses écrits sont remarquables par la tonalité grave du malheur collectif. Celui qui se veut la traduction des échecs d’un pays et dénonce leur origine. Cela s’appelle la littérature engagée, un genre que l’on retrouve dans la plupart des publications datant de la période coloniale. Un réalisme sans fard qui parle aussi bien de la terre blessée que de l’Algérien vaincu par tant d’iniquités. Fertilisés grâce au limon de la langue dialectale, les premiers écrits de Dib, Mammeri, Feraoun, Kateb et Haddad devinrent, par la suite, les textes fondateurs de la littérature algérienne à laquelle fut attribuée la paternité du fameux « souffle épique de Novembre ». Alors que l’on pensait que celui-ci était éteint définitivement, l’on assiste de nos jours à une autre version de sa résurrection grâce à la fournée de texte que « le Hirak » du 22 février a inspirée. Du roman jusqu’à l’essai politique, la réappropriation du caractère révolutionnaire de « la cause du peuple » n’atteste-t-elle pas, en effet, de son entrée dans l’Histoire ? Et cela quoi que disent et prédisent les clercs pontifiant sur les plateaux des médias qui n’hésitèrent pas à qualifier de « cohorte de chats » les somptueuses marches qui se sont succédé durant neuf mois.
L’on comprend certes que leur misérable désarroi résulte des contraintes de la servitude qui exige d’eux de ne jamais changer de lunettes.
Or, en cette saison particulière des livres, ce qui a prédominé dans le choix des lecteurs fut justement la littérature traitant du « Hirak » et essentiellement ce qu’il représente comme repère futur d’une Algérie différente. En quelques mots, il ne sera rien d’autre que la prochaine signature de la renaissance d’un Etat succédant à celui de 1954. Cela veut dire que dans le domaine littéraire, si la décolonisation est depuis quelque temps devenue un thème ringard pour les écrivains de la seconde génération, c’est parce qu’il leur semblait légitime que la société était en droit d’exiger d’autres références s’inscrivant dans le présent. Sans avoir été une dissidence qui manifeste le désir d’en finir avec l’école de la glorification, le nouveau roman allait de soi satisfaire les attentes du lectorat. Evidemment, la discrète rupture entre deux générations d’écrivains accouchera, par la suite, d’une contre-culture qui irriguera également les arts plastiques et le théâtre. Par leur talent, les Djaout et Mimouni se révélèrent comme des auteurs vaccinés contre le conformisme du passé. Cependant, l’on oublia que celui qui, le premier, manifesta son désir d’en finir avec l’emphase patriotarde affectant aussi bien le récit que la prose poétique n’était autre qu’un certain Ahmed Azzegagh.
En effet, dès juillet 1954, la revue Novembre publia cinq courts poèmes de cet auteur que Malek Haddad allait préfacer mais avec une prudence de jésuite.
Il écrivait justement ceci : « La chose est rassurante. Je viens de lire, je viens d’écouter un jeune poète, un nouveau poète. Le mot « relève » prend chez moi la vigueur des promesses tenues. Azzegagh m’a raconté son âge et son talent. Je voudrais qu’il éternise son âge dans son talent. Et je voudrais qu’il chasse les nuages et que les soleils soient innombrables (…). Dès lors qu’un poète publie, il doit des comptes à ses lecteurs, déjà, il ne s’appartient plus. Pour se libérer de sa créance, il lui faut du cœur et faire beau. Je n’aime ni les préfaces ni les présentations. Je ne suis la caution de personne .» A la lecture de l’éloge voilé adressé en son temps à ce barde à peine sorti de l’adolescence, l’on devine la crainte de la censure chez Malek Haddad. Il est vrai qu’à son époque, le devoir de tout écrivain militant consistait à diffuser de « l’optimisme » dès lors que toute plume « sombre » est sujette à la suspicion même si, en aparté, l’on admettait sa clairvoyance.
Comme tous les écorchés vifs, c’était donc à ce précurseur du « pessimisme salutaire » que la littérature du présent doit sa vigueur et sa notoriété grâce aux ouvrages qui viennent d’être publiés. Pour s’être mis en devoir d’écouter les pulsations de la rue, ces auteurs-là ne pouvaient écrire qu’avec des mots justes. Bien mieux que les sollicitations de l’imagination, « le Hirak » et son incontestable réalité a fini par être la seule muse capable de donner des œuvres majeures. C’est ainsi que dans le genre narratif, le récit de Benchicou intitulé La casa d’El Mouradia illustre parfaitement les causes de ce soulèvement. Sur le même thème, il a également permis au romancier Mustapha Yalaoui d’anticiper sur le déroulement des mêmes évènements en décrivant les péripéties d’une manifestation itinérante intitulée Le bal des vaincus. Parallèlement à la fiction, plusieurs essais d’analyse lui sont également consacrés notamment ceux de Mehdi Boukhalfa et Mohamed Mebtoul, deux auteurs dont les travaux sont édifiants. C’est dire que beaucoup de talent et d’humilité ont été nécessaires pour mettre en lumière la quête émanant du peuple. A ce propos, il y aurait parmi ceux qui eurent la pugnacité de raconter au plus près le déroulement de ces journées de grâce de 2019, certains d’entre eux se souviennent justement des répliques sans concession de ce poète qui, en son temps, parvint à clouer au pilori les censeurs en leur citant une formule d’auteur qu’il affectionnait tant : « L’écrivain, répétait-il, a le devoir d’aller ‘’trop loin’’, les autres sauront bien lui apprendre où passe le frontière .» C’est de la sorte qu’il réfutait l’autocensure en appelant au devoir de la contestation. Et ce n’est pas là le moindre des paradoxes de ce pays qui, malgré l’imposture de ses dirigeants, parvient à garder intact un souffle de vérité qui ne dérange que les scribes officiels plus prompts à la menace et à l’insulte.
B. H.